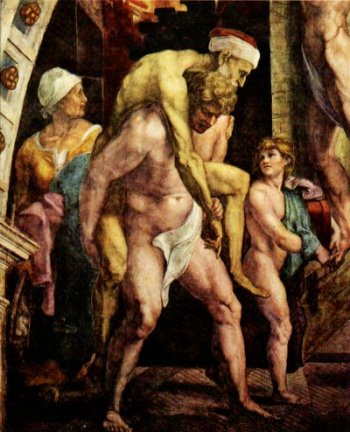http://www.nimispauci.com/OGR/OGR.htm
http://www.janus-labd.com/frp/janus_histoire.htm
|
La naissance de Rome : |
|
Quelques générations plus tard un de ses descendants,
Numitor fils de Proca, renversé par son frère Amulius, voit son fils
assassiné et sa fille Rhéa Silvia vouée à la déesse Vesta et au célibat.
Après une visite particulière du dieu Mars, la vestale devient mère de deux
jumeaux, Romulus et Rémus, qui sont livrés aux flots furieux du Tibre par le
roi non moins furieux.
Les eaux déposent les enfants au pied du mont Palatin sous un figuier mais,
trop petits, ils sont d'abord nourris par une louve sauvage puis par l'épouse
de Faustulus, intendant royal ou berger.
|
|
Dix huit années plus tard,
les deux frères se mettent au service de Numitor. Le trône restitué à leur
grand-père maternel et l'oncle-usurpateur massacré, ils se rendent, avec
leurs supporters, sur le Mont Palatin pour fonder leur propre ville.
|
La Rome royale (les sept rois de Rome
753-509) :
Romulus (753-715) fait de sa ville un asile pour hors-la-loi. Manquant
d'affection, ceux-ci enlevent les Sabines qui, à l'inverse de la malheureuse
Tarpéia et faisant contre infortune bon coeur, contribuent à la fusion des deux
peuples. Un orage élève Romulus au rang des dieux.
Numa Pompilius (715-672), gendre du roi sabin
Tatius, inspiré par sa nymphe Égérie organise la vie religieuse (temple de
Vesta, temple de Janus, année de 12 mois ... ). À sa mort, Diane le transforme
en fontaine.
|
Tullus
Hostilius (672-640), sabin lui aussi,
mène la lutte contre Albe. Au prix d'une ruse moyennement loyale légitimée
par un retentissant "qu'il mourût" Horace
parvient à se débarrasser des Curiaces et de sa soeur Camille. Albe est rasée
et ses habitants déportés à Rome. Après quoi Tullus Hostilius fait construire
quelques temples jusqu'à ce que Jupiter excédé jette la foudre sur sa maison. |
|
Ancus Martius
(640-616), neveu de Numa Pompilius est sabin lui aussi. Il étend Rome
jusqu'au Janicule en jetant le pont Sublicius sur le Tibre et au delà de la mer
en créant le port d'Ostie. Il brise la résistance des Latins, les déporte sur
le mont Aventin ou les enferme dans la prison du Tullianum au flanc du
Capitole.
Tarquinius Priscus (616-578) , Tarquin
l'Ancien, étrusque et fils d'immigré corinthien, est tuteur des enfants d'Ancus
Martius. Poussé par sa femme Tanaquil il s'empare du trône et rend possible
l'aménagement de la plaine entre les collines (Vélabre) en faisant construire
le Cloaca Maxima, le Forum Romanum, le Circus Maximus, ... Il domine les
Latins, les Sabins et les Étrusques mais ne peut échapper à la vengeance des
fils d'Ancus Martius. Tanaquil réapparaît pour donner le pouvoir à son gendre !
Servius Tullius (578-534), fils d'esclave !,
établit la division administrative du territoire en quartiers ou régions et la
répartition de la population en classes pour faciliter le recrutement de
l'armée. Il fait construire la grande enceinte de 11,500 km qui entoure la
ville et meurt victime d'un complot organisé par sa fille et son gendre.
|
Tarquinius
Superbus (534-509), Tarquin le Superbe,
abolit la constitution mais achève les grands travaux de Servius Tullius et
fait construire le temple de Jupiter Capitolin. Son fils Sextus force
Lucrèce, femme de Tarquin Collatin. Le viol de Lucrèce et son suicide
provoquent la révolte du peuple romain conduit par le veuf et Junius Brutus.
Le roi est chassé en Étrurie. |
|
La République (509-27) :
La République romaine ("res
publica") repose sur l'équilibre théorique de trois pouvoirs : deux
magistrats (consuls) nommés chaque année par les comices populaires gouvernent
sous la tutelle du sénat. Les temps héroïques tracés par Tite-Live) sont
dominés par :
- les luttes intestines entre patriciens et plébeiens (sécession de la plèbe
sur le Mont Sacré, Ménélius Agrippa et la fable des Membres et de l'Estomac)
jusqu'à l'égalité civile reconnue par la Loi des XII tables (450),
|
|
- les guerres de conquête
contre les Étrusques (le roi Porsenna, la main
de Mucius Scaevola, l'oeil d'Horatius Coclès, l'honneur de Clélie), la ligue
des Latins, les Volsques (la vengeance de Gnaeus Marcius Coriolanus),
les Èques (la charrue de Lucius Quinctius Cincinnatus), Véies (le dictateur
Marcus Furius Camillus), les Gaulois (Brennus et les oies du Capitole), les
Samnites (les Fourches-Caudines !), Pyrrhus, Carthage, ... jusqu'à
l'Empire, la "pax romana" et la
revanche des barbares. |
Les monuments de la Rome antique : (Cliquez sur l'image pour une
vue plus générale)

1 - Circus Maximus - 2 - Colisée - 3 - Forum Romanum, Curie (Sénat) et Basilica
Julia - 4 - Temple de Jupiter Capitolin et Roche Tarpéienne - 5 - Aqueduc de
Néron vers le Palatin - 6 - Aqueduc de Caracalla vers l'Aventin - 7 - Forum de
Trajan et Temple de Mars - 8 - Temple de Vénus et de Rome - 9 - Basilique de
Maxence - a - Temple de Claude - b - Arc de triomphe de Constantin - c - Palais
de Septime Sévère - d - Temple de Jupiter Victor - e - Théatre de Marcellus
N. B. : Les faits relatés ci-dessus n'engagent pas la responsabilité de
l'auteur.
S'adresser à Publius Vergilius Maro "Æneis" et Titus Livius "Ab
urbe condita libri" pour toute rectification.
|
|
|
|
Histoire et mythologie
Janus est une
divinité romaine sur les origines de laquelle les mythologues s’interrogent.
Les uns le pensent d’origine scythes tandis que les autres le croient
originaire d’une peuplade de Thessalie ; les Perrhèbes. La dernière hypothèse
en fait le fils d’Apollon et de Créuse, fille d’Erechtée, roi d’Athènes. Devenu grand,
Janus aurait équipé une flotte qui se serait emparé d’une partie de la
péninsule italienne sur laquelle il aurait fondée la ville de Janicule. Quelle que
soit ses origines la légende le fait régner, dès les premiers âges, dans le
Latium où Saturne, chassé du ciel, se réfugia. Janus le recueillit, allant
jusqu’à lui faire partager le pouvoir royal. Afin de le
récompenser de sa générosité, le dieu détrôné le dota du don de voir à la
fois le passé et l’avenir pour le prémunir contre les coups du destin. Janus avance
donc un visage tourné vers le passé et un autre vers l’avenir. Dans cette
légende, Janus assume tous les rôles initiaux. Ainsi passe-t-il également
pour avoir été jadis identique au Chaos.
Son règne fut
prospère et pacifique. C’est à ce titre qu’on le considéra comme le dieu de
la paix. Le roi Numa lui fit bâtir un temple à Rome qui restait ouvert en temps
de guerre et que l’on refermait lorsque venait la paix. Ce temple ne fut
fermé qu’une fois sous le règne de Numa (vers 715-672 av JC). Puis une
seconde fois après la fin de la deuxième guerre punique ( III° siècle avant
JC) et trois fois, à divers intervalles, durant le règne d’Auguste (63 av JC
– 14 ap JC). Ovide disait
que Janus était représenté avec un double visage parce qu’il exerçait son
pouvoir aussi bien sur terre que sur la mer ou au ciel.
Son nom est
tiré du verbe « aller » (ab eundo) ce qui exprime clairement le sentiment des
anciens à son égard, c’est pourquoi les passages ouverts des rues s’appellent
des iani et les portes au seuil des édifices profanes des ianuae. Aussi
ancien que le monde, tout s’ouvre et se ferme à sa volonté. Lui seul gouverne
la vaste étendue de l’univers. Il préside aux portes du ciel de concert avec
les Heures. Il observe en même temps l’orient et l’occident. On le
représente avec une clé à la main et à l’autre une verge pour marquer qu’il est
le gardien des portes et qu’il préside aux chemins. Ses statues marquent
souvent de la main droite le nombre de trois cents et de la gauche celui de
soixante cinq pour exprimer la mesure de l’année. Il était
invoqué le premier lorsqu’on faisait un sacrifice à quelque autre dieu.
Cicéron atteste en effet cette particularité ainsi que Varron dans sa célèbre
formule citée par Augustin : « Penes Ianum sunt
prima, penes Iouem summa » (Janus préside
à tout ce qui commence, Jupiter à tout ce qui culmine. Il y avait à
Rome plusieurs temples de Janus, les uns de Janus Bifrons, les autres de
Janus Quadrifrons. Au delà de la porte du Janicule, on avait élevé, en dehors
des murs de Rome douze autels de Janus par rapport aux douze mois de l’année. En tant
qu’initiateur du temps, le mois de janvier (januarius) auquel le roi Numa
donna son nom, lui était consacré. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Spiritisme,
alchimie et occultisme
SpectacleGloires oubliéesGastronomieBeaux LivresCarnet mondainHistoire et mythologie |
|
|
|
De l’avantage d’ être un Janus...
Il serait, à
n’en pas douter, totalement stupide de se lancer dans l’aventure fascinante
mais périlleuse du Janus si cela ne présentait quelques avantages de taille. Outre le fait
que votre force, votre adresse, votre endurance, votre détente, votre
vitesse… enfin toutes ces choses si fort prisées par nos athlètes modernes,
se verront décuplées lors de la fusion, on note une nette amélioration de la
résistance à la douleur et aux blessures de toutes sortes. Ce qui présente
certains avantages que nous ne développerons pas ici mais que vous devinerez
sans peine.
Toutefois, il
nous paraît de notre devoir de rappeler que si vous étiez tenté de vous
servir de ce moyen malhonnête afin de grappiller quelque médaille olympique,
il s’agirait d’un cas avéré de tricherie, assimilable à du dopage et qui vous
vaudrait l’ire de la communauté sportive internationale en général et du
Baron Pierre de Coubertin en particulier ! Ceci précisé, il
nous reste à ajouter que si le vivant profite pleinement des pouvoirs
conférés, l’esprit a également fort à gagner dans l’affaire. En effet, outre
qu’il peut jouir à nouveau de ses sens par l’entremise de son partenaire et
avec l’accord explicite de ce dernier, il verra s’accroître les pouvoirs dont
il disposait en tant que revenant.
Bien sûr, apprivoiser
les forces de l’invisible est une tâche ardue et tous n’y sont pas aptes.
Seuls les plus forts, ceux qui disposaient de leur vivant d’assez de sagesse
et de connaissance y parviennent. Il est sans
doute utile d’ajouter à cet effet que tant que l’esprit garde intact toutes
les connaissances qui étaient les siennes lorsqu’il vivait, il est préférable
de le choisir aussi érudit que possible. Imaginez les
longues années de vie (car la longévité d’un Janus n’est pas celle d’un homme
du commun) d’un homme de notre temps qui serait coincé avec l’esprit d’un
barbare ou d’un cuistre ! Cette perspective ne vous paraît-elle pas
effrayante ? Etant donné
l’intimité qui sera la vôtre durant de longues années, nous conseillons enfin
pour terminer d’éviter de joindre deux âmes de sexes opposés. Ne pensez-vous
pas qu’il serait en effet fort incommode voire inconvenant d’être contraints,
messieurs, à vous livrer à vos ablutions matinales devant une personne du
beau sexe ? |
|
Et de ses légers inconvénients...
On pourrait
croire, à première vue, qu’il n’existe que des avantages à la situation
sus-décrite. Ce serait oublier trop vite que disposer de tels pouvoirs implique
certains sacrifices ainsi que de lourdes responsabilités.
|
|
|
Nausées... |
On ne pourrait
que vous reprocher, par exemple, de ne rien faire pour lutter contre les méchants
et autres vilains qui hantent notre si belle planète. On pourrait exiger, par
exemple, que vous vous décarcassiez pour restaurer la paix dans le monde,
libérer l’opprimé et lutter aux côtés de la veuve et de l’orphelin.
Il serait
également de fort bon ton que vous n’omettiez pas, dans vos aventures, le sort
des animaux en voie de disparition voire, même, que vous vous souciiez de faire
un petit geste en faveur de l’environnement.
Bien sûr, les
grands héros sont souvent les plus modestes et comme le grand Héraclès tomba
autrefois dans la vulgarité à force d’auto-promotion bruyante, vous saurez,
avec charme et élégance, œuvrer dans le calme et la discrétion.
Bien sûr, tout
ceci vous entraînera parfois dans une suite d’aventures rocambolesques, semées de
péripéties diverses et variées où vous frôlerez, avec courage et abnégation,
maints périls et sans doute la mort elle-même.
|
|
|
...
maux de tête... |
Sans compter qu’après
que vous aurez, devant vos proches, amis et parents, parlé à voix haute à un
être que vous seul voyez, votre réputation d’original, voire pire peut-être,
sera faite. Il vous faudra prendre à cet égard un luxe incroyable de
précautions pour ne pas finir enfermé dans une institution spécialisée. Ce qui,
vous en conviendrez sans peine, pourrait se révéler excessivement désagréable.
Tout ceci vous
paraîtra sans doute peu de chose lorsque nous aurons abordé le chapitre des
relations amoureuses... car, hélas, il convient d’aborder avec sérieux cette
épineuse et dramatique question.
Vous l’aurez
compris, puisque le Janus est double et ne jouit que d’une intimité très
réduite, il est fort difficile au vivant de maintenir une vie sociale et
amoureuse convenable. Quant à fonder une famille, il n’y faut point songer.
|
|
|
... et dangers |
Quel homme serait
celui qui exposerait la pudeur d’une jeune épousée aux regards d’un autre
homme, certes décédé depuis parfois fort longtemps mais néanmoins homme et doté
encore, en fait de sens, tout au moins de la vue !
Il serait de
semblable façon tout à fait malséant que l’esprit tombât amoureux à son tour
d’une vivante puisqu’il n’aurait aucun espoir de concrétiser leur amour par un
pieux mariage ce qui aurait certainement pour conséquence de plonger l’un et
l’autre dans le pire désarroi.
N’ayons pas peur
de le dire, le Janus doit aspirer à la chasteté et se consacrer à sa seule
mission ! A cette condition et à cette condition seulement, il sera capable de
porter sur ses nobles épaules l’avenir
OGR
Origo gentis romanae
Les origines du peuple romain
Les origines du peuple romain,
depuis les fondateurs, Janus et Saturne, à
travers l’histoire des grands hommes qui se sont succédé
[1] jusqu’au dixième consulat de Constance.
Oeuvre composée d’après l’autorité de Verrius Flaccus, d’Antias (puisque
Verrius lui-même a préféré la graphie Antias à celle d’Antia), ensuite d’après
les annales des pontifes ; en outre d’après Cincius, Égnatius, Véranius,
Fabius Pictor, Licinius Macrus, Varron, César, Tubéron, et tous les historiens
anciens ; puis, pour les époques suivantes, d’après les affirmations de
chacun des modernes, c’est-à-dire Tite-Live et Victor l’Africain.
I,1. On croit que le premier qui
vint en Italie fut Saturne, ainsi que l’atteste aussi la Muse virgilienne, dans
ces vers connus :
Le premier qui vint de l’Olympe céleste fut Saturne,
fuyant les armes de Jupiter [2] ,
etc.
I, 2. Les hommes des temps
anciens, au moins jusqu’à cette époque, étaient, d’après la tradition, simples,
au point que, si des étrangers arrivaient chez eux, capables de les aider par
leur sagesse et leur jugement, de manière qu’ils puissent améliorer leurs
conditions de vie et affiner leurs moeurs, parce qu’ils ne connaissaient d’eux
ni l’origine ni les ancêtres, ils les croyaient nés du Ciel et de la Terre, et
les donnaient aussi pour tels à leurs descendants ; ainsi déclarèrent-ils
Saturne lui-même né du Ciel et de la Terre.
I, 3. En dépit de de cette
tradition, il est certain que Janus arriva en
Italie avant Saturne, qu’à son arrivée il accueillit ensuite.
I, 4. Ainsi faut-il comprendre
que Virgile qualifie Saturne de « premier », non par ignorance de
l’histoire ancienne, mais parce que tel était le sens qu’il donnait
habituellement à ce mot : il ne voulait pas dire que personne ne l’avait
précédé, mais qu’il était le personnage principal, comme dans les mots
« qui le premier des rivages de Troie. »
I, 5. Il ne fait aucun doute
qu’Anténor aborda en Italie avant Énée et qu’il fonda la ville de Padoue, non
sur la côte proche du rivage, mais à l’intérieur des terres [c’est-à-dire en
Illyrie], comme Virgile le dit lui-même dans les vers qu’il prête à Vénus,
lorsque la déesse se plaint à Jupiter des épreuves de son enfant Énée :
Anténor, lui, après avoir échappé aux Achéens, a pu pénétrer
dans les golfes d’Illyrie et gagner en toute quiétude le
coeur [3] ,
etc.
I, 6. Pourquoi donc Virgile
a-t-il ajouté «en toute quiétude » ? Nous avons essayé de
l’éclaircir, de manière approfondie, à l’endroit voulu, dans le commentaire que
nous avons commencé à rédiger, d’après la documentation fournie par le livre
intitulé L’origine de Padoue.
I, 7. Dans le cas présent, primus
est utilisé avec un sens identique à celui qu’on trouve au deuxième livre de l’Énéide,
dans l’énumération de ceux qui sortent du cheval de bois.
I, 8. Après avoir cité
Thersandre, Sthénélos, Ulysse, Acamas, Thoas, Néoptolème, le poète ajoute
« primusque Machaon » (et Machaon le premier).
I, 9. On peut alors se poser la
question : comment peut-il être qualifié de primus, celui qui est
mentionné après tant d’autres ? Mais nous comprendrons primus dans
le sens de personnage éminent, précisément parce que Machaon, suivant la
tradition, a été, en son temps, d’une habileté exceptionnelle dans l’art de la
médecine.
*
II, 1. Mais revenons au sujet
qui nous occupe. On raconte que Créüse, la fille d’Érechthée, roi d’Athènes,
jeune fille d’une grande beauté, fut violée par Apollon, et mit au monde un
enfant mâle qui fut ensuite envoyé à Delphes pour y être élevé. Quant à Créüse,
son père, qui ignorait tout, la donna [ou l’unit] en mariage à un proche, un
certain Xouthos.
II, 2. Comme il n’arrivait pas à
avoir d’enfants de Créüse, il se rendit à Delphes afin d’interroger l’oracle
sur ce qu’il convenait de faire pour pouvoir devenir père. Le dieu lui répondit
d’adopter celui qu’il trouverait sur sa route, le jour suivant.
II, 3. Il rencontra justement cet
enfant, dont nous venons de dire qu’il était le fils d’Apollon, et Xouthos
l’adopta.
II, 4. Quand il fut parvenu à
l’adolescence, mécontent du règne de son père, Janus
fit voile vers l’Italie avec une grande flotte ; arrivé dans le Latium, il
s’installa sur une hauteur et y fonda une cité, qu’il appela Janicule, à partir
de son nom même.
*
III, 1. Tandis que Janus régnait sur des indigènes frustes et incultes,
Saturne, chassé de son royaume, trouva refuge en Italie, où on lui accorda une
bienveillante hospitalité ; non loin du Janicule, il fonda une citadelle
et, de son nom, il l’appela Saturnia.
III, 2. Le premier il enseigna
l’agriculture ; ces hommes frustes, et habitués à vivre de rapines, il les
conduisit vers une forme de vie organisée, comme le dit Virgile dans le livre
VIII de l’Énéide :
Habitaient ces bois les Faunes et les Nymphes indigènes,
ainsi qu’une race d’hommes nés du tronc de chênes durs,
êtres sans coutumes ni culture, qui ne savaient ni atteler
des taureaux,
ni amasser des richesses, ni épargner ce qu’ils avaient
acquis ;
la cueillette et la chasse des bêtes sauvages assuraient
leur subsistance [4] .
III, 3. Se détournant de Janus, qui
ne lui avait rien enseigné, hormis les rites du culte divin et les cérémonies
religieuses, la population préféra se lier à Saturne, qui inculqua dans ces
esprits encore sauvages une conception plus élevée de vie et de comportement
moral, dans l’intérêt général ; comme nous l’avons déjà dit, il enseigna
l’art de cultiver la terre ; c’est à quoi se réfèrent ces deux vers :
Il rassembla cette race indocile et dispersée en haut des
collines,
pour lui imposer des lois. Il choisit d’appeler ce lieu
Latium [5] , etc.
III, 4. Suivant la tradition,
Saturne introduisit également l’usage de travailler le bronze et de battre la
monnaie sur un coin : sur une face figurait la tête de Janus, sur l’autre
l’effigie du navire qui l’avait amené en cette terre.
III, 5. C’est pourquoi, encore
aujourd’hui, les joueurs présentent à leurs adversaires une pièce de monnaie,
en la couvrant de la main, et en les invitant à deviner ce qu’il y a
au-dessous, la tête ou le navire (ce mot, dans le langage courant, a été
déformé en navia).
III, 6. Aujourd’hui encore la maison
qui se trouve sur les pentes du Capitole, où il tenait caché son argent, est
appelée « Trésor de Saturne ».
III, 7. Toutefois, comme nous l’avons
déjà dit, Janus était arrivé avant lui : aussi, quand il fut décidé, après
leur disparition, de leur distribuer à tous deux les honneurs divins, dans
toutes les cérémonies sacrées, la première place fut donnée à Janus ; même
lorsqu’on leur sacrifie en même temps qu’aux autres dieux, après que l’encens a
été répandu sur l’autel, Janus est nommé le premier ; et on accolle à son
nom l’épithète de Père, ainsi que l’atteste aussi notre poète :
La première fut fondée par le dieu Janus, l’autre par
Saturne [6] ;
ajoutant aussitôt après :
L’une fut appelée Janicule, l’autre Saturnia [7] .
III, 8. À lui, Janus, parce qu’il
possédait l’admirable capacité de rappeler le passé et aussi de prévoir le
futur... (Virgile) a dit :
Le roi Latinus, bien vieux déjà, régnait
sur des villes et des campagnes depuis longtemps pacifiées
et sereines [8] .
Pendant son règne, selon Virgile,
les Troyens arrivèrent en Italie.
III, 9. On se demande comment
Salluste a pu écrire : « et avec eux les Aborigènes, race d’hommes
agrestes, sans lois, sans gouvernement, libre et sans contrainte » [9] .
*
IV, 1. Certains, pour leur part,
rapportent que, quand les terres étaient recouvertes un peu partout des eaux du
déluge, de nombreux hommes, de diverses régions, s’établirent sur les montagnes
où ils avaient trouvé refuge ; puis, certains d’entre eux, en quête d’un
nouveau domicile, arrivèrent en Italie et furent appelés
« Aborigènes », d’un mot venant du grec, car en cette langue les
sommets des montagnes sont dits ![]() .
.
IV, 2. Selon d’autres, ils se
seraient tout d’abord appelés « Aberrigènes » parce qu’ils arrivèrent
en ce lieu après avoir erré : par la suite, une lettre ayant changé, une
autre ayant été ôtée, ils prirent le nom d’« Aborigènes ».
IV, 3. Picus les accueillit et leur
permit de vivre comme ils le voudraient.
IV, 4. En Italie, après Picus, régna
Faunus ; son nom dériverait du verbe fari, (dire), car il avait
coutume de prédire l’avenir, en des vers que nous appelons
« saturniens » ; ce genre de vers fut utilisé, pour la première
fois, dans une prophétie faite à Saturnie.
IV, 5. Ennius en témoigne, quand il
déclare :
En des vers qu’autrefois chantaient faunes et devins.
IV, 6. Ce Faunus, dont il est
question, la plupart l’identifie à Silvain, dont le nom vient de silva,
ou au dieu Inuus, certains même à Pan.
*
V, 1. Sous le règne de Faunus,
quelque soixante ans avant la venue d’Énée en Italie, l’Arcadien Évandre, fils
de Mercure et de la nymphe Carmentis, y aborda avec sa mère.
V, 2. Cette dernière, aux dires de
certains, portait tout d’abord le nom de Nicostrata, puis celui de Carmenta, de
carmen, car, très versée dans les lettres et capable de prévoir le
futur, elle avait coutume de faire des prédictions en vers ; la plupart
estime encore que ce n’est pas le nom de Carmenta qui vient de carmen,
mais bien que ce sont les carmina qui ont été appelés ainsi, de celle
qui les récitait.
V, 3. Évandre, donc, vint en Italie
sur les conseils de sa mère et, grâce à son extraordinaire culture et à sa
connaissance de l’alphabet, en peu de temps il s’acquit l’estime de Faunus.
Après avoir reçu de lui une hospitalité bienveillante, il obtint en récompense
un territoire assez vaste où s’établir. Il le partagea entre ses compagnons, et
leurs domiciles furent construits sur la montagne qu’ils appelaient alors
Pallanté, du nom de Pallas, et que nous, ensuite, nous avons appelé le Palatin.
Il y consacra un temple à Pan, qui est un dieu cher aux Arcadiens, comme
l’atteste Virgile en disant :
Pan, dieu de l’Arcadie, te séduisit et te trompa, ô Lune [10] ,
et aussi :
Pan, même, au tribunal de l’Arcadie, se mesurait avec moi
Pan, même, au tribunal de l’Arcadie, s’avouerait battu.
V, 4. Le premier, Évandre enseigna
aux habitants de l’Italie à lire et à écrire avec un alphabet qu’il avait en
partie appris auparavant ; il leur montra la culture des céréales,
découverte pour la première fois en Grèce ; il leur enseigna l’art de
semer, et fut le premier en Italie à atteler les boeufs pour labourer la terre.
*
VI, 1. Sous le règne d’Évandre, un
certain Tricaranus, d’origine grecque, arriva dans le Latium ; c’était un
berger d’une taille gigantesque et d’une grande force, qu’on appelait Hercule
parce qu’il dépassait tout le monde pour l’aspect et le courage.
VI, 2. Tandis que ses troupeaux
paissaient le long des rives du fleuve Albula, Cacus, un esclave d’Évandre,
mauvais, rusé, et de surcroît très cupide, déroba quelques génisses à
Tricaranus et, pour ne laisser aucun indice, il les traîna dans une grotte en
les tirant par la queue.
VI, 3. Tricaranus parcourut les
régions voisines et explora les cachettes possibles mais, à la fin, désespérant
de les retrouver, et résigné désormais à subir sereinement leur perte, il avait
décidé d’abandonner la région.
VI, 4. Quand Évandre, homme d’une
très grande justice, apprit comment les faits s’étaient produits, il fit punir
l’esclave et restitua les génisses volées.
VI, 5. Tricaranus consacra alors,
aux pentes de l’Aventin, un autel au Père Inventeur, lui donna le nom de
Maxima, sur lequel il offrit ensuite la dixième partie de son troupeau.
VI, 6. L’usage le plus ancien était
de donner aux souverains la dixième partie des récoltes ; mais il parut à
Tricaranus plus juste que les dieux profitent de cette offrande, plutôt que les
rois. De là vint la coutume de consacrer la dîme à Hercule ; c’est à quoi
Plaute
[11] se réfère, à travers l’expression
« la part d’Hercule », qui signifie précisément le dixième.
VI, 7. Tricaranus, donc, dédia l’Ara
Maxima et consacra la dîme ; et comme, quoique invitée, Carmenta ne se
présenta pas, il établit qu’aucune femme n’aurait le droit de se nourrir de ce
qui avait été offert sur cet autel ; et, de fait, les femmes furent sans
exception exclues du rite. C’est ce que Cassius raconte dans son premier livre.
*
VII, 1. Cependant, dans les livres
des Questions pontificales, on rapporte qu’Hercule, le fils de Jupiter
et d’Alcmène, après sa victoire sur Géryon, emmenant avec lui son célèbre
troupeau, et désireux d’introduire en Grèce des boeufs de cette race, arriva
par hasard dans le Latium et, ayant admiré la richesse du pâturage, il décida
de s’y arrêter un moment afin que les hommes qui l’accompagnaient, mais aussi
les animaux, puissent récupérer des fatigues du long voyage.
VII, 2. Les animaux furent mis
à paître, librement, là où se trouve aujourd’hui le Cirque Maxime, car on
pensait que nul n’oserait toucher au bien d’Hercule. Or, un brigand de la
région, qui dépassait tout le monde par son aspect physique et son courage,
tira huit génisses dans une grotte en les traînant par la queue, afin de ne pas
laisser de trace de son larcin.
VII, 3. Quand Hercule, en partant,
poussait le reste de son troupeau, par hasard il passa près de la grotte, et
les génisses qui s’y trouvaient renfermées bleuglèrent au moment où les autres
passèrent devant elles : ainsi le vol fut découvert.
VII, 4. Quand il apprit
qu’Hercule avait tué Cacus, Évandre alla le trouver pour le remercier d’avoir
libéré son territoire d’un si grand fléau ; et dès qu’il apprit quels étaient
ses parents, Évandre rapporta à Faunus comment s’était déroulée toute cette
histoire. Alors Faunus désira ardemment devenir son ami. Cette version des
événements n’a pas été suivie par notre Virgile.
*
VIII, 1. Celui qui consacra le Grand
Autel au Père Découvreur, qu’il s’agisse de Tricaranus ou d’Hercule, fit
venir deux Italiens, Potitius et Pinarius, afin de leur enseigner comment
célébrer ce culte suivant un rituel précis.
VIII, 2. Mais tandis que Potitius,
arrivé le premier, fut autorisé à brûler les viscères des victimes, Pinarius,
qui vint avec du retard, fut exclu du festin, lui et tous ses descendants.
Aujourd’hui encore, la règle veut qu’aucun membre de la famille de Pinarius
puisse consommer durant le sacrifice.
VIII, 3. Il y en a qui soutiennent
que les Pinarius s’appelaient auparavant d’une autre façon, et qu’ensuite ils
prirent leur nom du grec ![]() ,
parce que des sacrifices de ce genre, où ils ne touchaient pas à la nourriture,
ils sortaient affamés.
,
parce que des sacrifices de ce genre, où ils ne touchaient pas à la nourriture,
ils sortaient affamés.
VIII, 4. Jusqu’à la censure d’Appius
Claudius, l’usage resta en vigueur, que les Pinarius soient admis au sacrifice
seulement après que les Potitius, qui le célébraient, se furent alimentés des
chairs du boeuf immolé, c’est-à-dire au moment où il ne restait plus rien.
VIII, 5. Cependant, Appius Claudius
convainquit, avec de l’argent, les Potitius qu’ils enseignent aux esclaves
publics le rituel public institué par Hercule, et aussi qu’ils y admettent les
femmes.
VIII, 6. On raconte, qu’à la suite
de cela, dans le laps de temps de trente jours, toute la famille des Potitius,
qui jusqu’alors avait détenu la priorité dans la célébration du sacrifice,
s’éteignit, et le devoir passa aux Pinarius ; ces derniers, soit par
crainte de la divinité, soit par religieuse dévotion, furent ensuite les
fidèles gardiens de ces rites.
*
IX, 1. Après Faunus, alors que son
fils Latinus régnait en Italie, Ilion était prise par les Grecs à cause de la
trahison d’Anténor et d’autres princes troyens : Énée, portant devant lui
les dieux Pénates, son père Anchise sur les épaules, et tirant par la main son
petit enfant, pendant la nuit essaya de fuir ; le jour étant venu, il fut
reconnu par ses ennemis, lesquels, le voyant chargé d’un si pieux fardeau, ne
l’arrêtèrent pas ; davantage : le roi Agamemnon lui permit d’aller où
il le voudrait. Énée se dirigea vers le mont Ida, où il équipa une flotte et,
sur le conseil de l’oracle, il partit vers l’Italie en compagnie de nombreux
hommes et femmes : tout cela, Alexandre d’Éphèse le raconte dans le
premier livre de son oeuvre La guerre Marse.
IX, 2. Lutatius, quant à lui,
rapporte que non seulement Anténor mais aussi Énée trahit sa patrie.
IX, 3. Le roi Agamemnon lui accorda
d’aller où il voudrait, et de prendre avec lui ce qu’il estimait le plus
précieux ; il emporta uniquement les dieux Pénates, son père et ses deux
petits enfants, comme certains disent ; selon d’autres, cependant, son
unique fils, qui s’appela d’abord Iule et, par la suite, Ascagne.
IX, 4. Impressionnés par tant de
piété, les chefs grecs permirent à Énée de revenir chez lui et d’emporter ce
qu’il voudrait ; il quitta Troie avec de grandes richesses et en compagnie
de nombreux compagnons de l’un et l’autre sexe ; il arriva en Italie, au
terme d’un long trajet en mer, et après avoir touché de nombreuses terres. Tout
d’abord, il débarqua en Thrace, où il fonda la cité d’Énus, qu’il appela ainsi
à partir de son nom.
IX, 5. Ensuite, ayant découvert la
perfidie de Polymestor à la suite de la mort de Polydoros, il s’éloigna et
atteignit l’île de Délos ; il repartit après avoir épousé Lavinia, la
fille d’Anios, prêtre d’Apollon, de laquelle prirent le nom les littoraux
laviniens.
IX, 6. Il franchit de nombreux
océans, il débarqua sur le promontoire de la côté italique près de Baies, dans
le voisinage du lac d’Averne, où il ensevelit son pilote Misène, mort de
maladie ; ce dernier donna son nom à la ville de Misène, comme l’écrit
aussi César dans le premier livre de ses Questions Pontificales, même
s’il affirme que ce Misène n’était pas pilote mais trompette.
IX, 7. Justement, Virgile tient
compte des deux versions, lorsqu’il écrit :
Alors le pieux Énée fit dresser un tombeau de dimensions
énormes
en l'honneur de l'homme, avec ses armes et ses rames et sa
trompette [12] .
IX, 8. Même si certains assurent,
sur l’autorité d’Homère, qu’au temps de la guerre de Troie l’usage de la
trompette était encore inconnu.
*
X, 1. Certains historiens ajoutent
que, sur ce littoral, Énée célébra les funérailles de Baia, la mère d’Euxinus,
son compagnon, morte d’une vieillesse avancée, près de l’étang situé entre
Misène et le lac d’Averne : ce lac prit son nom. Ayant ensuite appris que
dans le voisinage, dans la ville qui s’appelle Cimmérium, une Sibylle prédisait
le futur aux mortels, il s’y rendit pour l’interroger sur sa situation future.
Il obtint la réponse, et il lui fut interdit d’ensevelir sur le sol italique
l’une de ses parentes.
X, 2. Après qu’Énée fut de retour à
sa flotte et trouva morte Prochytas, une parente qu’il avait laissée en bonne
santé, il lui donna une sépulture sur une île voisine, qui aujourd’hui encore
conserve son nom, comme l’écrivent Lutatius, Acilius et Pison.
X, 3. Parti de là, il arriva à une
localité, que nous appelons le port de Caiète, du nom de la nourrice d’Énée qui
y mourut et y fut enterrée.
X, 4. Toutefois, César et Sempronius
affirment que Caiète n’est pas un nom mais un surnom qui lui fut donné, car les
femmes troyennes, conseillées et exhortées par Caiète, fatiguées du long
voyage, mirent en ce lieu le feu aux navires : le nom viendrait du grec
qui signifie « incendier ».
X, 5. Ensuite Énée arriva dans la
région d’Italie, où régnait alors Latinus, appelée laurente du nom de la plante
du laurier. Avec son père Anchise, avec tous ses compagnons, descendus des
navires, il s’étendit sur le rivage et, quand il eut consommé toute la
nourriture qu’il possédait, il mangea aussi la croûte des galettes de froment
qu’il emportait pour les sacrifices.
*
XI, 1. Alors Anchise conjectura
qu’ils étaient arrivés au terme de leurs souffrances et de leurs
errances ; il se souvenait en effet qu’autrefois Vénus lui avait prédit
que le jour où, sur le rivage d’un pays étranger, poussés par la faim ils
dévoreraient même les tables consacrées, précisément en ce lieu, par la volonté
du destin, ils devraient fonder leur nouvel établissement.
XI, 2. En outre, une truie pleine,
menée du navire à terre pour être immolée, se libéra des mains des
sacrificateurs ; Énée se rappela alors la réponse d’un oracle ancien,
qu’un quadrupède le guiderait jusqu’au lieu où il fonderait la nouvelle ville.
XI, 3. C’est pourquoi il se mit à la
suivre, en emportant aussi les images des dieux pénates ; sur le sol où la
bête se coucha et mit bas trente porcelets, Énée, après avoir pris les auspices
et immolé la truie, fonda une cité, qu’il appela Lavinium, comme l’attestent
César dans son premier livre, et Lutatius dans son second livre.
*
XII, 1. Selon Domitius il ne
s’agissait pas de galettes de froment, comme écrit plus haut, mais de branches
de persil, abondantes en ce lieu, qui furent utilisées pour manger, en guise de
tables. Quand ils eurent fini le repas, ils mangèrent également le persil, et
aussitôt ils comprirent qu’il s’agissait là des tables que, selon la
prédiction, ils devaient manger.
XII, 2. La truie ayant été immolée,
et tandis qu’il faisait un sacrifice sur le rivage, on rapporte qu’Énée
s’aperçut par hasard de l’arrivée d’une flotte grecque où se trouvait Ulysse.
Craignant de courir un danger, s’il était reconnu par ses ennemis, mais
jugeant comme le pire sacrilège d’interrompre la cérémonie, il se couvrit
le visage d’un voile et mena à terme le sacrifice sans rien négliger. C’est
ainsi que naquit la coutume, observée par les descendants, de sacrifier le
visage couvert, comme l’écrit Marcus Octavius dans son premier livre.
XII, 3. Dans son premier livre,
Domitius nous informe au contraire qu’Énée, suivant le conseil de l’oracle de
Délos, devait se diriger vers l’Italie et fonder une ville, là où il trouverait
deux mers et, en plus de son repas, où il mangerait aussi les tables.
XII, 4. Quand Énée débarqua dans le
territoire laurente, qu’il s’éloigna un peu du rivage, il arriva près de deux
étangs d’eau salée, voisins l’un de l’autre. Il s’y lava et s’y restaura en
mangeant également le persil qu’il avait utilisé comme table ; et
comprenant qu’il s’agissait sans aucun doute des deux mers, car l’eau des
étangs était saline, et qu’il avait consommé les tables — formées par une
couche de persil — il fonda la cité en ce lieu et l’appela Lavinia, parce
qu’il s’était lavé dans un étang. Par la suite, Latinus, le roi des Aborigènes,
lui donna cinq cents arpents de terre pour qu’il y habite.
XII, 5. Caton, pour sa part,
dans ses Origines du peuple romain, raconte ceci : une truie mit
bas trente porcelets où se trouve à présent Lavinium ; Énée, qui avait
décidé de construire là-même une cité, déplorait la pauvreté du terrain ;
mais en songe lui apparurent les images des dieux pénates : ils
l’exhortèrent à poursuivre son projet de fonder la cité, qu’il avait
commencé : après autant d’années que la truie avait mis bas de porcelets,
les Troyens se transféreraient dans des lieux fertiles et dans un territoire
plus riche, en fondant une cité au nom clair entre tous, en Italie.
*
XIII, 1. Quand on annonça à
Latinus, le roi des Aborigènes, qu’un grand nombre d’étrangers, venus de la mer,
avaient envahi le territoire laurente, il mena sans tarder ses troupes contre
ces ennemis imprévus et inattendus. Avant d’engager la bataille, il remarqua
que les Troyens étaient dotés de tout l’équipement nécessaire au combat, alors
que ses sujets étaient armés de pierres et de bâtons, et protégés seulement par
des tuniques et des peaux qu’ils tenaient enroulés autour du bras gauche pour
se défendre.
XIII, 2. Aussi Latinus suspendit
l’affrontement et vint parlementer avec les Troyens ; il leur demanda qui
ils étaient, et ce qu’ils voulaient, cette décision ayant été prise sur ordre
de la divinité ; maintes fois en effet, les entrailles des victimes et les
visions qu’il avait eues en songe l’avaient averti qu’il se garderait mieux de
ses ennemis s’il unissait ses forces à des étrangers.
XIII, 3. Quand il apprit qu’Énée et
Anchise, chassés de leur patrie à cause de la guerre, erraient avec les
simulacres des dieux en quête d’un lieu où s’établir, il conclut avec un eux un
pacte d’amitié ; ils se jurèrent réciproquement qu’ils auraient des amis
et des ennemis communs.
XIII, 4. Ainsi les Troyens
commencèrent à fortifier leur cité, qu’Énée appela Lavinium, du nom de son
épouse, la fille du roi Latinus, qui dans un premier temps avait été promise à
Turnus.
XIII, 5. Cependant, la reine Amata,
la femme de Latinus, tolérait mal que Lavinia, ayant répudié Turnus, qui était
son cousin, épouse un étranger troyen ; elle incita Turnus à prendre les
armes. Il rassembla l’armée des Rutules et attaqua le territoire laurente :
le roi Latinus, avec Énée, se porta contre lui mais, au milieu des combats, il
fut encerclé et tué.
XIII, 6. Après la mort de son
beau-père, Énée continua de résister aux Rutules, et il tua même Turnus.
XIII, 7. Ayant défait et mis en
fuite ses ennemis, il rentra en vainqueur à Lavinium avec ses soldats, et, à
l’unanimité, il fut proclamé roi des Latins, comme l’écrit Lutatius dans son
troisième livre.
XIII, 8. Pison soutient pour sa part
que Turnus était le cousin d’Amata, et qu’après la mort de Latinus au combat,
elle s’ôta la vie.
*
XIV, 1. Donc, Énée, après avoir tué
Turnus, s’empara du pouvoir. Comme il ressentait encore de la colère envers les
Rutules, il décida de les harceler sans trêve, par des actions de guerre ;
ils implorèrent de l’Étrurie l’aide de Mézence, le roi d’Agylla, avec la
promesse qu’en cas de victoire, tout ce qui appartenait aux Latins lui serait
cédé.
XIV, 2. Comme ses soldats étaient en
infériorité numérique, Énée mit à l’abri dans la cité tout ce qu’il devait
impérativement sauver ; il établit son camp sous Lavinium, et plaça son
fils Euryléon au commandement ; quant à lui, ayant choisi le moment
opportun pour attaquer, il fit avancer ses soldats en ordre de bataille près de
l’étang formé par les eaux du Numicius. Tandis que l’on combattait âprement en
ce lieu, le ciel s’obscurcit à cause d’une tourmente subite, et aussitôt une
pluie battante commença de tomber, accompagnée de tonnerres et d’éclats
d’éclairs, au point que non seulement les yeux étaient aveuglés, mais les
esprits également troublés. Les combattants des deux camps ne désiraient pas
autre chose que mettre fin à la bataille ; néanmoins, Énée, enlevé dans le
bouleversement de cette tempête imprévue, n’apparut plus parmi les mortels.
XIV, 3. On rapporte par ailleurs qu’il
ne se doutait pas être près du fleuve et, poussé depuis le rivage, il tomba
dans l’eau ; ainsi la bataille prit-elle fin. Dans la suite, toutefois,
quand les nuées s’écartèrent et se dissipèrent, et que resplendit le ciel
clair, on crut qu’il avait été admis vivant au ciel.
XIV, 4. Plus tard, Ascagne et
quelques autres affirmèrent qu’ils l’avaient vu au-dessus de la rive du fleuve
Numicius avec les mêmes vêtements et les mêmes armes avec lesquelles il était
entré dans la bataille ; cela servit à renforcer la réputation de son
immortalité. Aussi en ce lieu un temple lui fut-il consacré, et on le vénéra en
tant que Père Indigète.
XIV, 5. Ensuite son fils Ascagne,
appelé aussi Euryléon, fut proclamé roi avec le consentement de tous les
Latins.
*
XV, 1. Quand il eut obtenu le
pouvoir suprême sur les Latins, Ascagne décida de continuer sans trêve la
guerre contre Mézence, dont le fils, Lausus, s’empara de la colline qui
constitue la citadelle de Lavinium ; comme la cité se trouvait serrée de toutes
parts par les troupes du roi, alors les Latins envoyèrent à Mézence une
ambassade pour lui demander à quelles conditions il accepterait leur reddition.
XV, 2. Or Mézence, entre autres
lourdes exigences, ajouta aussi qu’on lui donne, durant plusieurs années, tout
le vin produit dans les terres latines ; alors sur le conseil et
l’autorité d’Ascagne, on préféra risquer de mourir en défendant sa liberté,
plutôt que de subir une pareille servitude.
XV, 3. Ainsi, après avoir consacré à
Jupiter, par un voeu public, le vin de toute la vendange, les Latins se
jetèrent hors de la cité et, ayant défait les assiégeants et tué Lausus, ils
contraignirent Mézence à la fuite.
XV, 4. Ce dernier, par la suite, par
l’envoi d’une ambassade, obtint l’amitié et l’alliance des Latins, comme
l’atteste Lucius César dans son premier livre, et également Aulus Postumius,
dans son oeuvre L’arrivée d’Énée, dédiée à [...].
XV, 5. Admirant le grand courage
d’Ascagne, les Latins, non seulement estimèrent qu’il était le descendant de
Jupiter, mais ils l’appelèrent d’abord Iole, abrégeant et transformant un peu
son nom, puis Iule : de lui descendit la famille Giulia, comme l’écrivent
César dans son deuxième livre, et Caton dans les Origines.
*
XVI, 1. Laissée enceinte par Énée,
Lavinia, par crainte de l’hostilité d’Ascagne, se réfugia dans une forêt,
auprès de Tyrrhus, berger des troupeaux de Latinus. Elle y mit au monde un
fils, qui fut appelé Silvius, d’après la nature du lieu.
XVI, 2. Mais le peuple des Latins,
imaginant que Lavinia avait été tuée en secret par Ascagne, conçut une grande
animosité à son égard, au point de le menacer avec les armes.
XVI, 3. Alors Ascagne tenta de se
disculper, par des serments, mais cela ne lui servit à rien. Il réussit
toutefois à apaiser un peu la colère populaire, en demandant un certain délai
afin d’entreprendre des recherches, et il promit qu’il comblerait de
récompenses considérables celui qui la retrouverait. Très vite Lavinia fut
retrouvée, et il la ramena à Lavinium avec son fils, et il l’aima et l’honora
comme sa mère.
XVI, 4. Cela lui fit regagner
la faveur du peuple, comme l’écrivent [Gaius] Cesare et [Sextus] Gellius dans
ses Origines du peuple romain.
XVI, 5. D’autres, au contraire,
racontent que, quand le peuple entier cherchait à contraindre Ascagne à rendre
Lavinia, et que lui jurait de ne pas l’avoir tuée, et de ne pas savoir où elle
se trouvait, le berger Tyrrhus, ayant demandé le silence, déclara à cette
nombreuse assemblée qu’il pouvait lui donner des renseignements, s’il obtenait
la promesse que leur sécurité, à lui, à Lavinia et à son enfant, serait
assurée. Ces garanties obtenues, il ramena Lavinia et son fils dans la cité.
*
XVII, 1. Après ces événements,
trente ans s’étant écoulés à Lavinium, Ascagne se rappela que le moment était
venu de fonder la nouvelle ville, conformément au nombre des porcelets nés de
la truie blanche. Observant attentivement la région alentour, il fut frappé par
la montagne, qui aujourd’hui s’appelle mont Albain, du nom de la cité qui s’y
dresse ; Ascagne y fonda une ville, que, d’après sa forme, il appela
Longue, parce qu’elle s’étend en longueur, et Blanche, de la couleur de la
truie.
XVII, 2. Il y transporta les
simulacres des pénates ; mais ces derniers, le jour suivant, réapparurent
à Lavinium ; ils furent reportés à Albe et, on disposa je ne sais combien
d’hommes pour les garder, ils retournèrent de nouveau à Lavinium, dans leur
ancien domicile.
XVII, 3. Personne n’osa plus les
déplacer une troisième fois, comme il a été écrit dans le quatrième livre des Annales
des Pontifes, dans le second de Cincius et de César, dans le premier de
Tubéron.
XVII, 4. À la mort d’Ascagne, un
différend s’éleva, pour l’obtention du pouvoir, entre Iule, son fils, et
Silvius Postumius né de Lavinia ; on s’interrogeait sur celui à qui il
devait revenir, du fils ou du petit-fils d’Énée. La décision incomba au peuple,
qui proclama Silvius roi, à l’unanimité.
XVII, 5. Ses descendants, qui
s’appelèrent tous Silvius, régnèrent sur Albe jusqu’à la fondation de Rome,
comme il est écrit dans le quatrième livre des Annales des Pontifes.
XVII, 6. Sous le règne de Latinus
Silvius, des colons s’établirent à Préneste, Tibur, Gabies, Tusculum, Cora,
Pométa, Labici, Crustumium, Caméria, Bovillae, et dans les autres cités
environnantes.
*
XVIII, 1. Tibérius Silvius, le fils
de Silvius [Postumus], lui succéda. Il fit la guerre aux populations voisines
qui l’attaquaient ; mais lors d’un combat, il fut poussé dans les eaux du
fleuve Albula, et y périt ; et ce fut la raison pour laquelle on changea
le nom du fleuve, comme l’écrivent Lucius Cincius dans son premier livre, et
Lutatius dans son troisième.
XVIII, 2. Après lui régna Arémulus
Silvius qui, dit-on, se distingua par son arrogance, non seulement envers les
hommes, mais aussi envers les dieux, au point qu’il se proclamait supérieur à
Jupiter lui-même ; il commandait à ses soldats, quand le ciel tonnait, de
frapper sur leurs boucliers avec leurs armes, et il prétendait qu’il savait
produire un son plus éclatant encore.
XVIII, 3. Mais il fut puni bien vite :
frappé par la foudre, et saisi dans un tourbillon de vent, il fut précipité
dans le lac d’Albe, comme il est écrit dans le quatrième livre des Annales
des Pontifes, et dans le second des Épitomes de Pison.
XVIII, 4. Aufidius, pourtant, dans
ses Épitomes, et Domitius, dans son premier livre, rapportent qu’il ne
mourut pas foudroyé, mais que son palais s’écroula lors d’un tremblement de
terre, et qu’il fut emporté et traîné avec les ruines de l’édifice dans le lac
d’Albe.
XVIII, 5. Après lui régna Aventinus
Silvius ; attaqué par les peuples voisins, lors de la bataille il fut
encerclé par les ennemis ; il mourut et fut enseveli au pied de la
montagne qui prit son nom, comme l’atteste Lucius César dans son deuxième
livre.
*
XIX, 1. Après Aventinus, le roi d’Albe,
Silvius Procas, laissa pour héritiers, à parts égales, ses deux fils, Numitor
et Amulius.
XIX, 2. Alors Amulius mit d’un côté
le seul pouvoir royal, de l’autre tout le patrimoine et les richesses de leur
père, et il laissa Numitor, qui était l’aîné, le droit de choisir ce qu’il
préférait.
XIX, 3. Au pouvoir, Numitor préféra
la tranquillité privée avec ses richesses, et ainsi Amulius obtint le règne.
XIX, 4. Pour renforcer son propre
pouvoir, il fit tuer le fils de Numitor, durant une partie de chasse ; il
décréta en outre que Rhéa Silvia, sa soeur, devînt prêtresse de Vesta, feignant
d’avoir eu une vision, où la déesse elle-même lui demandait cela. En réalité,
il prit cette décision parce qu’il estimait dangereux que de Rhéa Silvia naisse
une descendance, qui vengerait les torts subis par leur aïeul, comme l’écrit
Valérius Antias dans son premier livre.
XIX, 5. Marcus Octavius et Licinius
Macer rapportent au contraire que ce fut Amulius lui-même, l’oncle de la
vestale Rhéa Silvia, qui, pris de passion pour elle, la viola dans le bois
sacré de Mars, profitant d’un ciel sombre et obscurci par les nuages, quand la
jeune fille, aux premières lueurs de l’aube, sortit pour puiser l’eau destinée
au culte. Le temps normal s’étant écoulé, deux jumeaux naquirent.
XIX, 6. L’ayant appris, Amulius,
afin que sa faute ne fût pas connue, ordonna que la prêtresse fût condamnée à
mort, et que les jumeaux lui fussent remis.
XIX, 7. Alors Numitor, en espérant
que dans l’avenir ses petits-enfants, devenus grands, vengeraient les offenses
subies, leur substitua d’autres nouveaux-nés, et confia ses vrais petits-fils à
Faustulus, le chef des bergers, pour qu’il les élève.
*
XX, 1. Au contraire, Fabius Pictor,
dans son premier livre, et Vennonius racontent que la jeune fille était sortie,
selon l’usage rituel, pour puiser l’eau nécessaire au culte, à une fontaine qui
se trouvait dans le bois sacré de Mars. Quand ses compagnes se dispersèrent en
fuyant, à cause d’une pluie soudaine et de tonnerres, elle fut violée par Mars,
et elle en demeura profondément troublée ; mais le dieu la réconforta en
lui révélant son identité, et en lui promettant qu’elle donnerait naissance à
une descendance digne de son père.
XX, 2. Dès qu’il sut que la
prêtresse avait accouché de deux jumeaux, le roi Amulius ordonna immédiatement
qu’ils soient portés au bord du fleuve, et abandonnés.
XX, 3. Ceux chargés d’exécuter
l’ordre placèrent les enfants dans une petite barque, et les abandonnèrent dans
le Tibre, au pied du Palatin, où un étang s’était formé, en raison des pluies
abondantes. Faustulus, un porcher de la région, les aperçut en train d’exposer
les enfants ; lorsque les eaux se furent retirées, il vit que la petite
barque avec les enfants s’était immobilisée auprès d’un figuier. Attirée par
les pleurs des bébés, une louve, qui venait de mettre bas, commença par les
lécher, puis elle leur offrit ses mamelles afin de les soulager. Alors
Faustulus s’approcha, recueillit les petits et les porta à sa femme, Acca
Larentia, pour qu’elle les nourrisse, comme l’écrivent Ennius dans son premier
livre, et César dans le second.
XX, 4. Certains ajoutent que, tandis
que Faustulus observait encore, un pivert également vola vers les enfants, le
bec plein de nourriture, qu’il leur donna ; d’où la conviction que le loup
et le pivert sont placés sous la protection de Mars. L’arbre, près duquel les
enfants furent abandonnés dans le fleuve, est appelé « figuier
ruminal », parce que sous son ombre le bétail a l’habitude de ruminer
pendant le repos de l’après-midi.
*
XXI, 1. Valérius raconte au
contraire qu’Amulius confia les enfants nés de Rhéa Silvia à son esclave
Faustulus pour qu’il les supprime ; mais celui-ci, prié par Numitor de
n’en rien faire, les donna à élever à Acca Larentia, sa maîtresse, qu’on
appelait « louve », parce qu’elle avait l’habitude de se prostituer
pour de l’argent.
XXI, 2. On sait en effet que ce
terme désigne les femmes qui font commerce de leur corps, et de là vient
l’usage d’appeler lupanars les lieux où elles sont logées.
XXI, 3. Par la suite, quand ils
furent en mesure de recevoir une éducation libérale, les jumeaux demeurèrent à
Gabies, pour y apprendre les lettres grecques et latines : leur aïeul
Numitor, en secret, pourvoyait à tout.
XXI, 4. Dès qu’ils atteignirent
l’adolescence, Romulus apprit, d’une révélation de Faustulus, qui était son
grand-père, qui était sa mère et quel destin il avait enduré : il se
dirigea aussitôt vers Albe avec une troupe de bergers armés, tua Amulius et
restitua le pouvoir royal à Numitor.
XXI, 5. Le nom de Romulus vient de
sa grande force et de sa valeur : en grec, on l’exprime par la parole ![]() .
Son frère, pour sa part, fut appelé Rémus, à cause de sa lenteur, parce que les
hommes d’une telle nature, autrefois, étaient nommés remores.
.
Son frère, pour sa part, fut appelé Rémus, à cause de sa lenteur, parce que les
hommes d’une telle nature, autrefois, étaient nommés remores.
*
XXII, 1. Après les événements qui
viennent d’être exposés, ayant célébré un sacrifice dans le lieu qu’on appelle
aujourd’hui Lupercal, Romulus et Rémus, coururent joyeusement, en frappant,
avec les peaux des victimes immolées, tous ceux qu’ils rencontraient sur leur
passage, et ils décrétèrent que ce sacrifice solennel reste en vigueur pour
eux-mêmes et pour leurs descendants, et ils donnèrent des noms différents à
leurs propres compagnons : Rémus les appela Fabius, Romulus Quintilius.
Ces noms sont encore en usage aujourd’hui au cours de cette cérémonie.
XXII, 2. Dans le second livre des Questions
pontificales, au contraire, on lit qu’Amulius envoya quelques-uns de ses
sujets pour capturer le berger Rémus, mais, n’osant pas le capturer par la
force, ils choisirent le moment opportun pour lui tendre une embuscade. En
l’absence de Romulus, ils feignirent de proposer un concours pour savoir qui
d’entre eux, les mains liées derrière le dos, serait capable de porter le plus
loin possible, en la tirant avec les dents, la pierre que l’on utilisait pour
peser la laine.
XXII, 3. Sûr de sa force, Rémus
promit qu’il la porterait jusqu’à l’Aventin ; mais dès qu’il eut accepté
de se faire ligoter, il fut emmené comme prisonnier à Albe. À son retour,
Romulus, informé de ce qui s’était passé, réunit aussitôt un grand nombre de
bergers ; il les divisa en groupes de cent hommes auxquels il distribua
des perches ; des manipules de foin, de formes variées, étaient attachés à
leur extrémité, pour que tous puissent plus facilement reconnaître et suivre
leur propre chef. De là vient le nom de « manipulaires », donné aux
soldats qui appartiennent au même groupe.
XXII, 4. Ainsi, ayant tué Amulius,
Romulus libéra son frère et rendit le règne à son aïeul Numitor.
*
XXIII, 1. Romulus et Rémus
projetèrent de fonder une ville, dans laquelle tous deux régneraient avec un
pouvoir égal ; Romulus estimait que l’endroit le mieux adapté était le
Palatin, et il voulait l’appeler Rome, alors que Rémus indiquait une autre
colline distante de cinq milles du Palatin, et dont il voulait que le lieu
prenne, d’après son nom, le nom de Rémoria. Comme la controverse s’éternisait,
leur aïeul Numitor ayant été pris pour arbitre, on décida de laisser les dieux
trancher ce différend : celui des deux frères qui, le premier, aurait des
auspices favorables, fonderait la cité, lui donnerait son nom et en deviendrait
roi.
XXIII, 2. Pour prendre les auspices,
Romulus se plaça sur le Palatin, et Rémus sur l’Aventin ; à Rémus, tout
d’abord, apparurent six vautours qui volaient ensemble, qui venaient de la
gauche. Il envoya annoncer à son frère qu’il avait déjà eu l’auspice qui lui
commandait de fonder la ville ; qu’il se dépêche, donc, de venir auprès de
lui.
XXIII, 3. Dès qu’il fut arrivé,
Romulus demanda quel avait été l’auspice, et Rémus lui répondit que, tandis
qu’il prenait l’auspice, il lui était apparu six vautours groupés. « Mais
moi, maintenant, je t’en montrerai douze ! » Et subitement apparurent
dans le ciel douze vautours, accompagnés d’un éclair et d’un coup de tonnerre.
XXIII, 4. Alors Romulus
ajouta : « Pourquoi, ô Rémus, vanter ce que tu as vu avant, quand
maintenant tu vois cela ? » Alors Rémus, comprenant que le règne lui
avait été soustrait : « En cette ville », s’exclama-t-il, « de
nombreux espoirs et des présomptions audacieuses se réaliseront de façon très
heureuse. »
XXIII, 5. Au contraire, Licinius
Macer, dans son premier livre, raconte que le différend se conclut
tragiquement, parce qu’aussi bien Rémus que Faustulus, qui voulaient résister,
furent tués.
XXIII, 6. Au contraire, Égnatus,
dans son premier livre, nie la fin tragique de Rémus, et soutient qu’il vécut
plus longtemps que Romulus.
[1] Le texte ajoute : « les uns aux autres »
[2] Virgile, Énéide (VIII, 319-320)
[3] Virgile, Énéide (I, 242-243)
[4] Virgile, Énéide (VIII, 314-318)
[5] Virgile, Énéide (VIII, 321-323)
[6] Virgile, Énéide (VIII, 357)
[7] Virgile, Énéide (VIII, 358)
[8] Virgile, Énéide (VII, 45-46)
[9] Salluste, Catilina, (VI)
[10] Virgile, Géorgiques, (III, 392)
[11] Plaute, Bacchides, (666)
[12] Virgile, Énéide (VI, 232-233)
Janus
|
|
|
|
Pièce de monnaie à l'effigie de Janus |
Statue de Janus à deux visages |
Janus est l'un des plus anciens et des plus grands dieux du panthéon romain.
Les mythologues ne sont pas tous d'accord sur son origine. Selon certains, Janus
était indigène à Rome, où il aurait autrefois régné avec Camèse (un roi
mythique). Selon d'autres, Janus était un étranger, originaire de
Thessalie et exilé à Rome, où il aurait été accueilli par Camèse, qui
aurait partagé son royaume avec lui. Janus aurait alors bâti une cité
sur la colline (elle aurait pris le nom de Janicule, d'après celui du dieu).
D'autres, encore, en font un fils d'Apollon et de Créuse.
Il fonda la ville de Janicule lorsqu'il aborda en Italie, dans le Latium en
compagnie de sa femme Camisè, avec qui il aura des enfants, notamment Tiber,
l'éponyme du Tibre. A la mort de Camèse, il continua de régner seul sur
le Latium et il accueillit Saturne,
chassé du ciel et de Grèce par son fils Jupiter. Par reconnaissance, Saturne
aurait donné à Janus le don de la «double science», celle du passé et
celle du futur. En effet, Janus est représenté avec deux visages tournés
en sens contraires. Ovide dit qu'il a un double visage parce qu'il exerce son
pouvoir sur le ciel, sur la mer comme sur la terre; tout s'ouvre ou se ferme à
sa volonté; il gouverne la vaste étendue de l'univers.
La règne de Janus fut pacifique. On le considéra donc comme le dieu de
la paix. Il est aussi la divinité des portes (car toute porte regarde des deux
côtés). Le roi Numa lui fit bâtir à Rome un temple. Ce temple est
orienté d'est en ouest et deux portes y donnaient accès, entre lesquelles
s'élevait une statue de Janus à deux visages. Lors d'une déclaration de guerre,
les Romains ouvrent les portes de son sanctuaire pour indiquer que le dieu est
parti combattre, et les referment dès que le dieu est de retour, donc en temps
de paix. Ce temple fut fermé une fois sous le règne de Numa, une
deuxième fois après la seconde guerre punique et trois fois sous le règne
d'Auguste. Janus préside aussi aux portes du ciel et les garde de
concert avec les Heures.
Grâce a son double visage, Janus contrôle aussi l'orient et l'occident.
Afin de montrer que Janus est le gardien des portes et qu'il préside aux
chemins, on le représente tenant d'une main une clef et de l'autre une verge.
On dit aussi que Janus est l'inventeur des bateaux (qu'il aurait utilisé
pour faire le voyage de Thessalie en Italie) et celui des pièces de monnaie. En
effet, les plus anciennes pièces de bronze romain portaient d'un côté l'effigie
de Janus et de l'autre une proue de bateau.
Janus est devenu le dieu de toute chose, celui de l'Année (il a
d'ailleurs donné son nom au moi de janvier: Januarius), le dieu des
Quatre Saisons (dans ce cas-là, il est alors représenté avec quatre têtes).
On dit aussi que Janus a épousé la Nymphe Juturne et qu'il aurait eu
avec elle un fils, le dieu Fons (dieu des sources).
Janus était aussi un habile orateur.
Une fois mort, Janus fut divinisé. Différentes légendes se rattachent à
lui, et en particulier celle qui raconte le miracle qui sauva Rome de la
conquête sabine.
Références littéraires
Suet., II, XXII :
|
Ianum Quirinum semel atque iterum a condita urbe
ante memoriam suam clausum
in multo breviore temporis
spatio terra marique pace parta ter clusit. Bis ouans (ovans) ingressus est urbem, post Philippense
et rursus post Siculum bellum. Curulis triumphos
tris egit, Delmaticum, Actiacum, Alexandrinum, continuo triduo omnes. |
Le temple de Janus Quirinus, qui n'avait été fermé que deux fois avant lui depuis la fondation de Rome, le fut trois fois sous son principat, dans un espace de temps beaucoup moins long, la paix se trouvant établie sur terre et sur mer. Il entra deux fois dans Rome avec les honneurs de l'ovation, d'abord après la guerre de Sicile. Il célébra trois triomphes curules, ceux de Dalmatie, d'Actium et d'Alexandrie, tous en trois jours de suite. |
Ov., F., I, 245-254 :
|
«...Arx mea collis
erat quem uolgus nomine nostro |
«... Ma citadelle était la colline que le public désigne par mon nom |
Sources
- Grimal P., Mythologie, Hachette, Paris, 1990, pp. 241-242
- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse, Paris, 1965, p.171
- Commelin P., Mythologie grecque et romaine, Classiques Garnier, 1948, pp. 196-198
- Le Grenier de Clio, «Mythologie gréco-romaine», <http://grenier2clio.free.fr/grec/romains.htm>, 21 avril 2002
- David Wagner et Tal Garfinkel, Janus, <http://www.cs.berkeley.edu/~daw/janus/>, 11 juin 2002
Indo-European
Chronology (III period)
Comments to the table
1250 BC Phrygians come from Balkans to Asia
Minor - the first Great Movement of Nations begins
After Illyrians began their
movement to the south from the Danube valley, Phrygian tribes which probably
came to the Balkans together with some branches of the Hellenic group were
forced to leave their settlements and start the migration which was to play an
important role in the whole Indo-European history.
Masses of Phrygian tribes,
which lived along the Lower Danube on fertile lands and therefore could be very
numerous, invaded countries inhabited by other nations, so the chain reaction
of migrations started. In two centuries the East Mediterranean will be in chaos
- two greatest civilizations will fall, thousands of people will change their
homes and homelands, countries will be plundered. The Bronze Age was replaced
by the Iron Age - the one we still live in.
Phrygians, who could make a
community with Hellenic and Armenian groups of the Indo-European family, are
believed to come from Asia via South Russian steppes. First they lived in the
northern Balkans, contacting with Thracians, Illyrians and Doric Greeks, and
now had to cross the Bosporus and to settle in West Asia Minor, among
non-Indo-European tribes who lived in Troy and other towns here.
More about Phrygian language
More about ancient languages of the
East Mediterranean
1250 BC First mentioning about
Lycians
The country which is named
"Lukka" in Hittite documents was for sure Lycia and was situated
along the southern shores of Anatolia. The name itself can be aboriginal:
Anatolian people were fond of borrowing names of towns, countries and
themselves from native population, Hittites got their name from Hatti, Palaic
tribes - from the country and town of Pala. Lycians were a branch of Luwians,
which moved westwards from Luwija and soon colonized these lands.
Their language was even
less Indo-European than Luwian, with quite a lot of loanwords, agglutinative
grammar features and even strange sounds which were picked up in Lycian: too
many nasals, for example. The structure of the language allows us to say that
it was for sure the descendant of Luwian.
Lycians are several times mentioned
in Egyptian sources (under different names) as one of the "Sea
Peoples" which started to act in the Mediterranean at this time. Another
region in Asia Minor, Cilicia, also derives from Lycians.
More about Lycian
language
More about Luwian
language
1250 BC Baltic peoples move
north and east
Around the 15th century BC the
division happened of the common Balto-Slavic ethnic group into two subbranches
- Slavic and Baltic. The most ancient traces of Baltic cultures can be found
along the Vistula and the Oder rivers; and now they began to migrate eastwards
and northwards - until in the 13th century reached the Baltic Sea and the
Daugava (Dvina) river. The archaeological discoveries show very close ties of
the population here with the Vistula region in the next several centuries.
These lands, modern
Lithuania, southern Latvia, northern Poland and parts of Belorussia, were at
that time occupied by Finnish tribes, living on hunting and fishing. But the
population was not dense in these woody regions, so Baltic peoples could find
much land to settle and cultivate. The mutual contacts of Finnish and
Indo-European nations led to the assimilation of Finns in the south, and vice
versa the assimilation of Balts in the north. Baltic languages acquired many
words, phonetic and morphological features from Finnish, which are seen even now
in Lithuanian and Latvian. As for those tribes which settled in what was later
Prussia, came into close contact with Slavic, thus accumulating much of the
relative Slavic grammar and vocabulary.
1230 BC "Sea
Peoples" destroy Hittite Kingdom, invade Syria, Palestine, Egypt
The epoch of "Sea
Peoples" was similar to later times of Hunns and Goths in the Roman
Empire, or Vikings in the Medieval Europe. Migrations in Southern Europe and
Asia Minor caused great masses of people to lead the nomadic style of life.
Thousands of people took up piracy and began traveling through the sea seeking
for a better country or just for plunder. The changes in the climate at that
time could also be a reason for generating such a wave of sea moves.
"Sea Peoples" did
not belong to the exact ethnic group, their armadas were composed of different
nations. Some of them are known, according to Egyptian, Hittite documents and
Greek myths; some names are unknown, they disappeared from the history.
Egyptians named Hellenes (Achaeans), Carians, peoples of Asia Minor. The Bible
tells about Philistines who are also considered as one of the "Sea
Peoples"; Greeks tell about Lelegs and Pelasgians, and also mention
Tyrsenians, future Etruscans who could come to Italy from Asia as well.
In several decades the
Hittite Kingdom was raided and destroyed - it will never rise again. At that
very time Mycenaean cities on Crete and Cyprus were turned into ruins and
conquered. Palestine and Syria were invaded, and for a long time were
struggling with aggressors. Egyptian lands in Palestine were lost - even the
Delta of the Nile was partly occupied by the pirate ships, and pharaoh Pamesses
III could hardly resist them. All these changes were accompanied by the Doric
invasion in Greece and the fall of the Mycenaean civilization.
More about Hittite history:
2100 BC 1600 BC 1750 BC 1450 BC 1350 BC
More about Sea Peoples
More about Pelasgians and their
language
1230 BC Achaeans conquer Troy
People long thought Homerus
simply invented Troy and the famous war for it. His epic was considered as one
of Greek myths, until an adventurer named Henrich Schlimann studied the
Homerus's texts attentively, went to Turkey and excavated Troy from one of
deserted hills.
The war described in detail
in the Greek epic, must have reflected one of the episodes of the war between
Asiatic shore cities and Greek polises, the war for trade profits. Triy was a
rather rich and influential, so Achaeans had to struggle cruel merchant
competition with it. It was evidently strong enough to resist the invasion, so
Hellenic countires had to unite in order to destroy the Asiatic power of Troy.
Another theory says that the Troy war was just one of "Sea Peoples"
naval raids - Achaeans were one of the most active "Sea Peoples" at
that time. The city of Mycenae and its king Agamemnon Atreides were joined by
several minor Greek polises and made the strong force.
The siege of the city
lasted ten years, according to the poem, and then was captured and destroyed.
Archaeological research shows that the town was eliminated by the fire.
Achaeans got the ooportunity to settle on fertile lands in West Asia Minor and
to found prosperous colonies there. But it was the last military victory of
Mycenaean Greeks; some 80 years later the civilization was crushed by Doric
invaders.
More about Achaean history:
2250 BC 1900 BC 1450 BC 1475 BC 1400 BC 1200 BC
1200 BC Achaeans start
migrating to Crete, Cyprus, Asia Minor
Constant pressing of Doric
and Aeolian tribes from the north of Greece, economic problems and other, maybe
unknown reasons force the Achaean population to leave their homes and go to
neighbouring Mediterranean islands, to Asia Minor and even to Southern Italy.
Probably, it was the first attempt of the future Great Greek Colonization.
Taking an important part in
the Sea Peoples' piracy, Achaeans gradually settled in Crete, Cyprus, on the
Aegean Islands, founded famous colonies on the Asiatic shores and developed old
ones, like Miletus, Galicarnassus, Colophon and others. At the same time the
Achaean military force was preparing to the invasion of Troy, the rich city in
Asia Minor.
Last relics of pre-Hellenic
population of islands in the Aegean and the Mediterranean were slowly
assimilated by Indo-Europeans from continental Greece.
More about Achaean history:
2250 BC 1900 BC 1450 BC 1475 BC 1400 BC 1230 BC
1200 BC Celtic cultures in
Gaul and Germania
From this time Celts gradually become the most powerful nation in Northern
Europe. They easily and quickly spread over vast lands of France (Gaul),
Germany, Low Countries, the Alps, penetrated on the Iberian peninsula. Celts
were wary and numerous which helped them to conquer lands of ancient European
tribes and to widen their domain.
Celtic tribes are believed
to have been moving first along the Middle Danube to the west; later their
cultures can be archaeologically traced in Southern Germany and in Central
Gaul; Celts slowly assimilated aboriginal peoples of those regions, and neolithic
cultures which flourished in Europe before Indo-Europeans came, were preserved
in the 12th century BC only in the Low Rhine lands, somewhere in the Alps and
on the peninsula of Brittany. The British Isles were not yet visited by the
Indo-European settlers, though continental cultures - Celtic, Germanic, Baltic
and Greek - developed trade contacts with the islands.
The Common Celtic language was at that time still very similar to its relatives
Italic, Illyrian and Venetic. Besides, Celtic words and word elements were
borrowed by Slavic and Germanic languages in this very early epoch.
More about Celtic history: 2100 BC 1400 BC 650 BC
Map of Celtic languages
More about Common Celtic language
1200 BC Illyrians arrive at
South Italy
Inscriptions discovered in south-eastern Italy, written in one of Italic
alphabets, were identified as using the language similar to Illyrian. After
Illyrians occupied the regions of Dalmatia and reached the Adriatic shores,
they crossed the narrow sea space and found themselves in Italy.
This migration is believed
to take place together with similar moves of Italic tribes from the Balkans to
Italy - we mean the second Italic wave, including Osco-Umbrian peoples.
Illyrians also settled on the Apennine peninsula, and lived there until they
were completely assimilated by Roman settlers.
This Illyrian branch was
called Messapic by ancient authors. Nowadays we can state that the Messapic
language was rather different from Illyrian: first of all in lexical composition,
where it shows many "italisisms". Messapic inscriptions are all of
the same type - burial sacred messages, that is why the grammar basis and the
known vocabulary of the language remain poor. It the 1st and the 2nd centuries
AD Messapic tribes in Italy mixed with Italics, and the language disappeared.
More about Messapic language
More about Illyrian language
Map of Italic languages
1200 BC Doric tribes invade
Greece; soon they destroy the Mycenaean civilization
The next step of the Great
Movement of Peoples was made in the early 13th century, when Doric tribes,
representatives of the Hellenic group of the Indo-European family, began
migrating south from the Balkans, to the centers f the Mycenaean civilization.
Mycenae and other cities of
Greece at that time were already rather weak: overcrowded by people who could
not provide enough food for themselves, deep involved and weakened in conflicts
of the Mediterranean (including the most famous of them: the Trojan War),
losing many favours of the overseas trade. That is why Doric invaders were
fortunate soon to destroy much of the civilization. City blocks of Mycenae were
burned, and its acropolis was destroyed. Tyrinth suffered constant attacks. The
king's palace in Pilos was totally destroyed and was never restored since then.
Doric peoples did not know
monarchy, they used a kind of military democracy, that is why were especially
fond of destroying palaces and houses of kings and nobles. Ancient city centers
were avoided at that time, and people did not want to settle there. Much of the
rich Mycenaean culture was, subsequently, lost, as well as the complicated
Achaean alphabet, which was useless for primitive peasants. Interesting, that
the Greek epic preserved some hostile attitude towards the writing itself: maybe
it reflected the attitude of people to state officers, tax collectors and their
records.
Doric possessed iron
working, but lacked culture, art and writing. A new period of civilization
began in Greece.
More about Doric language
Map of Hellenic languages
1100 BC Thracian peoples
arrive to Balkans
At this time (or even
earlier) archaeological cultures which are believed to have been connected with
Thracians occupy the territory of modern Romania, Bulgaria and reach the Aegean
Sea. Together with Illyrians and Doric Greeks, Thracians were following
Phrygians in their way south, but while Phrygians mostly preferred to cross the
Marmare Sea and go to Asia Minor, Thracians remained in Europe.
Long contacts and close
relations between Thracians, Phrygians and Illyrians made many linguists think
that these three languages were close relatives. But that can be not true:
Illyrian possesses several features that make it closer to Italic, Celtic and
even Tocharic languages, Phrygian shows similarities with Greek and Armenian,
and Thracian appeared to have had many common peculiarities with Balto-Slavic tongues.
Thracians spread over the
fertile lands of the Lower Danube and its tributaries, and soon became very
numerous. Rich gold and silver deposits were found here, and this made
Thracians one of the richest and powerful nations of East Europe of that time.
However, they still did not manage to create the state, and live by tribes:
scientists distinguish Dacians, Paeonians, and many others.
More about Thracian language
More about Dacian language
More about Paleo-Balkan languages
1100 BC New wave of Italics
comes to Italy
This meant the last effect
of the Movement of Peoples which began two centuries before on the northern
Balkans. After Illyrian tribes (Messapic) found the short sea way from Dalmatia
to Italy, Italics which still lived next to Illyrians also began penetrating to
Italy, where their closer relatives already lived - first Italics, Latins and
Faliscans, came to Italy from the north-east even about 2000 BC.
Now was the turn of this
new wave, which presented Oscan and Umbrian peoples in Italy. They occupied
mainly the eastern and southern regions of the peninsula, the fact which proves
they did not go from the north. Osco-Umbrians migrants assimilated or mixed
with aboriginal Italic tribes, partly acquiring their language features, their
religion and often even their names. Picens, for example, worshipped the
wood-pecker (picus in Latin), an autochthonic deity, and acquired
their name from it, maybe because the real name of the tribe was too hard fro
Indo-Europeans to pronounce (the same happened with Picts in Scotland).
Umbrians is also a pre-Italic name. Many linguistic features in Umbrian,
Picene, Volscian are strange enough to be identified as the substratum.
Some linguists think
Latino-Faliscan and Osco-Umbrian subgroups are separate and do not belong to
one Italic group. In this case the contacts between them must have been very
intimate, to elaborate the vocabulary and the grammar so much alike.
Map of Italic languages
More about Oscan language
More about Umbrian language
Despite many bright
statements which can be found on the Web nowadays, the Etruscan problem remains
with us, and their origin and their language classification are still unknown.
If we summarize all that has been said and found about Etruscans, we can see
that the majority of discoveries confirm ancient theories of their Asiatic
homeland. Several historical facts, archaeological relics, words from Egyptian,
Greek and Italic sources, some similarities between Etruscan and Hurrian
languages, and finally the problem of the Lemnos Stele - all these are in
favour of Asia Minor as the original land of Etruscans.
They came to Italy and
occupied northern and partly central districts of the peninsula. Soon, due to overseas
trading and contacts with higher civilizations of Phoenicians, Greeks and
Egyptians, Etruscans acquired writing, invented their own alphabet and brought
up their original culture, so unlike other cultures of that time Europe.
Linguists have been studying
the links between Etruscan and other language families for many centuries
already, but still little progress was done. One of the great mysteries of
Europe still fascinates.
More about Etruscan
history: 474 BC 50 AD
More about Etruscan language
More about ancient Mediterranean
languages
More about Etruscan Alphabet
The Indo-Iranian peoples
may have compiled one common epic when they lived together, before the
linguistic and geographical division. But the writing, and, therefore, written
variants of this epic appeared much later, and in Iran this happened already in
the new era. Avesta was the collection of the religious texts, the most ancient
of which tell about archaic Indo-European beliefs, and later are influenced by
Zoroastrism. Though Avesta was created and declared sacred in about 8th century
BC, its first codification took place a thousand years later. All these years
the epic existed in its oral form, and the language in which it was spoken was
already dead.
Many historians believe it
was Zoroastr himself who codified and tried to systematize the songs of Avesta.
Anyway, this oral tradition, later written, is the most valuable sources of
ancient Iranian languages. Though the most ancient Avestan texts which exist
nowadays date back to the 13th century AD, no doubt that the language they use
is much older.
More about Avestan language
More about Avestan Script
753 BC Rome is founded by
Latins
This year Rome was born on the seven hills - this statement is not true.
Already in the 9th century BC a little tribe of Italics came to this place,
which was rather attractive for living: the Tiber is wide and calm here, in its
mouth people discovered salt deposits, hills were fertile. The first hill to be
inhabited was Palatine, where ancient relics of houses and irrigation can be
found. Later on Latins settled on Janicule, where
an ancient village of aborigines existed for ages. Sabines, another Italic
tribe relative to Latins, occupied Quirinale, Viminale, Esquilin. Some settlers
appeared on the hill of Celius. And the seventh hill was the Capitol which was
settled later.
So the ancient legends of
Romul who unified Latins and Sabines are not quite true - they just mixed
within these seven hills. We don't know who managed to unify all seven into one
town - it must have happened synthetically and naturally, due to the increasing
population which had to occupy the valley between the hills.
On the other bank of the
Tiber there were lands of Etruscans, who gradually expanded their domains. In
Rome Etruscan blocks of houses played an important role, practically all trade
relations were conducted with Etruscans, and much of the religion was also
borrowed from them. According to the traditional history of Rome, the first
king was Romulus, a Latin. He was succeeded by Numa Pompilius, a Sabine, and
then by Tullus Gostilius, a Latin again. The next king was a Latin again, Ancus
Marcius, and in 616 BC the Etruscans take power in Rome - their leader Lucumon
from Tarquinii (Lucii Tarquinii) was declared king. Since then, Etruscans ruled
the city until 510 BC.
More about Roman history: 510 BC 267 BC
More about Latin language
Map of Italic languages
750 BC - 250 AD Phrygian inscriptions
About 200 inscriptions found in Asia Minor, mainly in Gordion, the capital of
the Phrygian kingdom, are called "Old Phrygian". They were written in
an alphabet which was very close to the Greek script. As the Phrygian language
is also close to Greek, a few linguists used to think at first that the documents
represented a Greek dialect. Usually the written sentences are short and, as
everywhere in the ancient world, were inscribed on burial stones etc. Some of
them, however, tell about historical events happened in Phrygia, and about the
deeds of Phrygian kings. Many inscriptions were also found on the
"graffiti" pottery.
The "New
Phrygian" texts date back to the 2nd - 3rd centuries AD. They were written
in the Greek alphabet, and the language itself at that time was influenced
strongly by Greek. There is a theory that these two periods of the inscriptions
are two different languages - Old and New Phrygian. But the more common point
of view is that they are only two stages of the development of the same
Phrygian language.
More about Phrygian
history: 738 BC 690 BC
More about Phrygian language
750 BC Greeks begin their
Great Colonization
First Greek settlements
appeared in Syria, Palestine and Cilicia already in the 9th century, but these
were not colonies (apoikia) yet, but trading points (emporia)
with quite small population. And about 750 BC Greek merchants from the island
of Euboia founded the first Greek colony abroad - Pitecussa in Southern Italy.
Soon Cumae, Naxos, Messana and Regius followed it, and the colonization became
constant. The most active polises who took part in colonizing new lands were
Euboian cities and towns of the northern Peloponnisos. As for Spartiats, for
example, they had only one colony, Tarent, which was used as the place for
exile from Sparta.
By the beginning of the
next century all the South Italian coast was occupied by numerous Greek
colonies. In 734 Corinthians founded Syracuse in Sicily, which later became the
most powerful and rich of all Greek colonies in the Mediterranean. Soon
colonies became so rich that in their turn settled in new settlements. That is
how citizens of Cumae founded NeaPolis (New City). Asiatic colonies sent
expeditions and settled on the Black Sea shores, and even reached the Caucasus.
The Greek presence in
foreign lands couldn't help influencing the life of aboriginal peoples. The
most strong Greek influence took place in Asia Minor, where languages of the
Anatolian group were borrowing many Greek words. The same thing can be said
about Italic tongues.
738 BC Phrygian Kingdom
founded in Asia Minor
Midas, a Phrygian leader,
married with a Greek woman, united all Phrygians, gained control over vast
treasuries, and founded the Phrygian kingdom. He built a city in the center of
the country, named Gordion, famous for its giant city walls, even now seen from
the sand.
Successful wars and
diplomacy allowed Midas to create a real power in Anatolia. He concluded an
alliance with Lydians, who lived to the south from Phrygia, subjugated
neighbouring tribes and stopped the expansion of the Assyrian Empire. In 709 BC
Midas and Sargon II of Assyria signed a peace treaty. Midas sponsored arts,
writing and construction in his country, and Phrygian inscriptions preserved
very grateful attitude towards him.
But already in 730 BC the
kingdom faced a new threat - nomadic Cymmerians from the Steppes.
More about Phrygian
history: 750 BC 690 BC
More about Phrygian language
730 BC Cymmerians invade
Europe and Asia and reach Pannonia and Lydia
Hordes of horseback nomadic
tribes which were called Cymmerians by Greek authors first showed what is so
terrible about the Asiatic nomads in Europe. At that time Central Asia was
beginning to suffer shortage of food for people and cattle because of the
global temperature rising, so since then masses of peoples from Asia began
their gradual expansion to both to Europe and to China where they could pillage
or settle. Another reason for migrations was the struggle among nomadic
peoples, for example, historians believe that Cymmerians were pushed from
Central Asia by Scythians.
Cymmerians were the first.
This people of Iranian origin, which came to the Caspian steppes from the
south, now moved west and invaded Eastern Europe, where they had to fight with
Thracians and Illyrians in Pannonia, and Asia Minor, where they came via the
Caucasus. In Anatolia, Cymmerians were first paid tribute and used as mercenary
troops for different empires (the usual Empires' way of treating nomads), but
later decided to demand more (see later).
This year the Assyrian
chronicle first mentions the mountainous country named Khaiasa in northern
Mesopotamia. This is believed to be the first mentioning of Armenians who lived
here for ages. Armenian peoples used to be too weak to found their own state,
and therefore had to survive under the Assyrian supremacy. But as the power of
the Assyrian Empire was declining, Armenians who called themselves
"Khai" were unified by several legendary kings of the tribe named
"Armi" and therefore started to play an important role in the history
of the Middle East.
In the 7th century BC
Armenians became quite numerous and spread over the western Anatolia and lands
along the Upper Euphrates. They assimilated Hurrians and Urartian, neighbouring
nations, and founded a kingdom which was long vassal to Media, and then to
Persia but in fact independent.
The Armenian language,
close to Greek, Phrygian, and Indic, preserved its original structure and
vocabulary. As well as the religion of Armenians, their language borrowed a lot
from Urartian and Hurrian, however laving untouched the vocabulary, which
remained quite Indo-European.
700 BC Lydian Kingdom founded
in Asia Minor
Lydia and its population
was mentioned already by Homer as Maeonians. Sardis, the capital of the
country, probably was founded even before Anatolian peoples came from the
Hittite Kingdom here to the West Asia Minor. Lydians mixed with the aboriginal
population and developed their own language descended directly from Hittite,
though with some significant innovations and changes.
Vast deposits of gold in
Lydia near the rivers Galis and Meandros, and the trade on naval and surface
ways from Europe to Asia made Lydians a rich people, and this fact encouraged
the development of the monarchy here. Until Phrygia was strong enough to
control all Asia Minor, Lydian kings had to live as Phrygian satellites. But now,
as the Phrygian kingdom was deeply involved into wars with Cymmerian invaders,
Aliattus, the king of Lydians, proclaimed independence. After the fall of the
Phrygian state, Lydia became the most powerful country in the region.
At this time the first Lydian
texts appear, written in a kind of the Greek alphabet with some diacritics for
special sounds.
700 BC Median Kingdom founded
in Iran
The Ancient Persian and
Greek tradition follows the theory that Medians came from the north to Iran,
being one of the branches of Scythians. But in the 8th century they mixed with
other Iranian tribes living in what is now Kurdistan and Azerbaijan, and became
a numerous and strong nation. Medians were illiterate and uncivilized, they had
only several cities, but were wary enough to resist the Assyrian Empire, and
finally in 625 BC together with Babylonians managed to crush the Assyrian
power.
The king named Kiaxar of
Media quickly expanded the borders of his kingdom, conquering Iran, Northern
Mesopotamia, even lands along the Indus and Asia Minor. As a result of long
wars with Lydia in Anatolia, Media set its borders with Lydia at the river
Galis. But endless wars and the weak administrative and economic system was a
fatal disadvantage for the kingdom.
Medians failed to influence
any of peoples conquered by them. When the kingdom was destroyed, Medians soon
disappeared, and two centuries later no one could even tell what the Median
language looked like, for very few inscriptions and documents were left from
them. The biggest state of the period, Media was fated to disappear.
690 BC Cymmerians destroy the
Phrygian Kingdom
Several attempts of
Phrygians to crush the nomadic power of Cymmerians appeared unsuccessful, and
this year nomads eliminated the Phrygian kingdom, destroyed and pillaged its
capital Gordion, and legendary king Midas had to commit a suicide.
Cymmerians were probably
allied with Lydians whose country was not touched by the nomadic wave. Lydians
were in hostile relations with Phrygia, so much of its territory now was occupied
by Lydia. But Phrygian peoples were not eliminated, and Phrygian inscriptions
still appear in Asia Minor.
As for the Cymmerians, they
did not know yet that their fate was already prepared. Lydian, Median and Babylonian
ambassadors were quickly moving to the Caspian Steppes to call another power to
destroy the Cymmerian strength in Asia.
More about Phrygian
history: 750 BC 738 BC
675 BC Scythians arrive to
Asia and eliminate Cymmerians
A new wave of nomads came
from Central Asia. Scythians crossed the Caucasus and appeared in northern Iran
and in Asia Minor. They had to play the decisive role in the political and
ethic processes which were going on in the Near East at that time. The
political balance between powers was too complicated to exist for long: the
power in Asia was divided between the moribund Assyrian Empire, the increasing
strength of the Median Kingdom, Lydia, the New Babylon Kingdom and Egypt.
After Cymmerians destroyed
Phrygia, they were becoming stronger and stronger. Kingdoms no longer wanted to
accept them as mercenary troops, and were glad to remove Cymmerians somehow
from Asia. Moreover, a strong alliance of Media, Babylon, Elam and Lydia
against Assyrians was not powerful enough to crush the Empire. That is why a
lot of states were interested in the Scythian help, and Scythians came.
In 655 Cymmerians were
eliminated, and disappeared from Asia, leaving only terrible memories. But
Assyrians managed to bribe Scythian leaders, and they refused the Babylonian
proposal to destroy Ninevia, the Assyrian capital.
Scythians were maybe not
quite Indo-European peoples, but a mixture of nations of Central Asia,
including some Turkish and Altaic element. Their language, though remaining
Iranian, carried a lot of borrowed non-Indo-European features. The Scythian language
influenced many tongues of Asia and Europe, including Slavic, Thracian, Baltic,
and Iranian.
650 BC Celts settle in Britain
and Ireland
This is not the exact date
of the Celtic emergence on the British Isles. But around this time Celtic
settlements begin to appear in southern Britain.
In the 9th and 8th
centuries BC the "urn culture" occupied much of Western Europe,
though not touching Northern Spain, Brittany and England. The Celts were
multiplying quite fast, and therefore needed new lands to settle. Small groups
of Celtic migrants arrived in Britain and occupied its fertile lands. In the
7th century BC cultural and economic ties between continental Europe and
Britain become closer, but while in Europe the Celts continue their fast
development and generate the material culture of Halstadt, the British Isles
begin to fall behind this development - the Channel leaves insular Celts in
isolation.
The Celtic coming to
Britain and later to Ireland, where they came into close contact with the Picts
and other aboriginal tribes of the islands, marks the important event in the
Indo-European history: now the languages of this family occupy all Europe and
the part of Asia which remains Indo-European today. Reaching the westernmost
regions of Europe, Indo-Europeans had to stop, and a new period of their
chronology begins.
Map of Celtic languages
Picts and Pictish language
la langue cananéenne qui, teintée de tournures araméennes ,devient l’hébreu de la Bible,la culture littéraire du II e millénaire (qu’il s’agisse de poèmes ougaritiques ou du fond mésopotamien) et même certains qui cosacrent les pratiques agricoles.
Mais le clergé des douzes tribus les empëchent d’adopter les sacrifices d’enfants et les cérémonies magiques et licencieuses de la fécondation du sol,chers aux sémites de Syrie
JANICULE

L'une des sept collines de Rome, située sur la rive droite du Tibre et qui était consacrée à Janus.
http://www.arnaudfrichphoto.com/e_europe_rome.htm


|
5)Le Janicule et sa
forteresse Poursuivons encore notre promenade et laissons-nous
conduire vers la ligne d’horizon et la lumière de Rome. Cette montagne qui se
dresse au milieu de la toile, c’est le mont du Janicule dans son état
primitif, surmonté de constructions antiques, édifiées à l’emplacement du
temple d’Isis. La forteresse du roi Sabin Ancus Martius, percée des deux
portes de Janus était déjà en ruines à l’époque de Pline. Ses restes, mêlés
peut-être à d’autres constructions médiévales demeurèrent encore visibles, du
moins jusqu’au XVe siècle au sommet de la colline. Il est à remarquer qu’ici,
Poussin n’a pas fait une oeuvre entièrement originale... Elevé à l’école de Raphaël et nourri des oeuvres de ce
dernier pour lequel il eut toujours la plus profonde admiration, il a
probablement reproduit la montagne couronnée de ruines qui compose le fond du
tableau de la „Transfiguration“ peint en 1517. Raphaël fut nommé en 1515
commissaire des antiquités. Vers 1518-1519, il supplia Léon X de sauvegarder
les vestiges antiques. Il proposa en ce sens d’effectuer leurs relevés
exacts, la coupe et l’élévation de ces monuments. En 1520, Raphaël a commencé son travail et Rome se voit
rétablie en majeure partie de sa figure antique, en son pourtour primitif et
dans les proportions de ses parties diverses. Dans ce but, Raphël a fait
entreprendre des fouilles à l’intérieur des collines et des fondations
profondes et les résultats concordent avec les descriptions et les dimensions
fournies par les auteurs anciens. Le plan de Raphël comprendrait 16 feuilles(8)...,
les 16 régions de la Rome antique! Ce sont ses amis et élèves qui vont en partie réaliser son
voeu: 1527, plans „Antiquates Urbis“ de Andrea Fulvio; 1544, „Urbia Romae
Topographia“ de Bart Marliano; 1518-1519 sur les bases et fondations
antiques, Turini fit construire une villa...du nom de Lante(9).
Les décorations furent exécutées par les élèves de Raphaël. Cette demeure
achetée et restaurée, appartient depuis 1948 à l’ambassade finlandaise. C’est
en 1656, que le Vatican fit applanir cette colline du Janicule pour en faire
un jardin d‘agrément. Ces travaux se sont terminés en même temps que les
rénovations du château Saint-Ange en 1659. Au pied du Janicule, un bosquet d’arbres symbolise
peut-être le bois de chêne vert qui recouvrait dans l’antiquité les monts du
Vatican et où naquit le culte de la nymphe Furrina, divinité des bois sacrés
et d‘une source, dont l’eau coule vers le devant de la toile, entre les
rochers, les arbres et les fleurs... Samothés, dit Janus – Mont Tabor, Tarentum
Nous sommes vers les années 1650-1660, au moment où
Rome resplendit au milieu de ses nouveaux palais. Des bâtiments à gauche de
la cour d’honneur du Vatican vinrent prendre place, là où subsiste le dernier
vestige de ce bois sacré. Au pied du Janicule, près du Vatican, Pline parle
d’une yeuse „chêne vert“ plus vieille que Rome. Plus tard, on planta une
vigne, qui rendit un vin au goût de vinaigre, dont disait Martial. „Boire
le vin du Vatican, c’est boire du poison(10)“. Les maisons de Rome furent couvertes avec des bardeaux
jusqu’à la guerre de Pyrrhus, pendant 470 ans. Il est certain que des forêts
remarquables étaient répandues dans son enceinte. Aujourd’hui encore le nom
de Jupiter Fagutal indique l’emplacement d‘un bois de hêtres... des chênes
étaient à la porte querquetulane... on allait chercher des osiers à la
colline vitimale... et, tant de lieux où se trouvait un bois et même deux. „Après
la retraite du peuple sur le Janicule, an de Rome 367, D. Hortensius
dictateur, porta dans l’Escalatum „bois de chênes“(11). Enfin, au pied du Janicule sur la droite, une ligne
horizontale plus sombre barre le paysage. C’est vraisemblablement le canal
construit à l'époque impériale pour alimenter les bains d'Agrippa. Les
vestiges de ce canal furent mis à jour lors des aménagements de ce jardin.
Quelques restes de monuments sacrés s’élèvent au milieu d‘une campagne
paisible. Au-delà de cette colline, c’est l’histoire de tout un quartier de
la Rome antique qui se déroule sous nos yeux, telle quelle se présentait dans
l’imagination de l’artiste. |
|
|
|
Le «parking de Dieu», lui, a vu le jour Urbanisme. Il y a cinq ans, la Ville éternelle s’apprêtait à construire à tort et à travers. Rome: Jean-Claude Berger Miracle! Le Pont Sixte (Ponte Sisto) vient
enfin d’être débarrassé de ses échafaudages, après avoir été méchamment
corseté pour les besoins d’une restauration qui durait depuis si longtemps
qu’elle avait fini par se faire oublier. Même les plus acharnés avaient
renoncé à s’indigner… Le plus beau pont de Rome a également été débarrassé
des deux passerelles métalliques dont on l’avait flanqué à la fin du siècle
dernier. La course contre la montre jubilaire a fait des miracles. © Le Temps. Signalez les erreurs à webmaster@letemps.ch |